Source : Mediapart
Les
deux formations anti-austérité, l'une grecque, l'autre espagnole, ont
les moyens de bousculer la donne politique en Europe en 2015. Audit de
la dette, euro, nationalisations, fiscalité… Les points communs sont
nombreux dans leur programme. Mais il subsiste quelques différences de
fond dans leur mode d'organisation. Décryptage croisé.
L'accélération du scénario grec, avec des élections législatives fixées au 25 janvier,
pourrait provoquer une première : la formation d'un gouvernement à
gauche de la social-démocratie dans un pays de l'UE (si l'on met de côté
les communistes chypriotes). Explosive, l'hypothèse est bien sûr suivie
de très près par d'autres partis frères ailleurs sur le continent. En
Espagne, en particulier, où Podemos, l'une des formations issues du
mouvement « indigné », semble bien parti pour mettre à mal le bipartisme
PP-PSOE lors des législatives d'octobre.
Syriza, Podemos : à eux deux, ces mouvements politiques, qui siègent ensemble à Strasbourg sous la bannière de la Gauche unitaire européenne (GUE), tiennent une bonne partie de l'avenir de l'UE entre leurs mains. Rien n'est fait mais, sur le papier, ils ont les moyens de faire bouger cette « Europe allemande » théorisée par le sociologue Ulrich Beck, à laquelle s'est heurté François Hollande. Cinq ans après l'éclatement de la crise des dettes souveraines en Europe, et autant d'années d'austérité sur le continent, ce serait une première, pour tester des alternatives dans l'Europe du Sud.
Les deux formations anti-austérité le savent, et leurs leaders – le Grec Alexis Tsipras, 40 ans, et l'Espagnol Pablo Iglesias, 36 ans – ne manquent pas une occasion de mettre en scène leur union politique. Lundi, après l'annonce du scrutin grec anticipé, Iglesias a encouragé, sur Twitter, son collègue : « 2015 sera l'année du changement en Espagne et en Europe. Ça commencera par la Grèce. En avant Alexis ! » En octobre 2014, lors d'un acte commun à Athènes, Tsipras avait déjà prévenu : « Podemos peut devenir l'autre Syriza en Europe, le Syriza espagnol. »
Dans une tribune publiée le 30 décembre dans le quotidien conservateur El Mundo, Pablo Iglesias en rajoute une couche : « Alexis sait tout autant que nous que remporter une élection ne suffit pas pour prendre le pouvoir, et que la marge d'action dans le contexte actuel et inévitable de l'Union, est étroite. Mais il sait aussi, tout autant que nous, que des vents de changement soufflent, et que les peuples du Sud de l'Europe (…) sont prêts à changer de cap, et à avancer vers une Europe où la justice sociale et la souveraineté populaire formeront les bases d'une démocratie qui saura s'imposer face à la peur. »
À première vue, les deux économies sont très différentes – la Grèce ne pèse plus que 2 % du PIB de la zone euro, contre 12 % pour l'Espagne (et 20 % pour la France). Mais les programmes de Syriza et Podemos présentent de nombreux points communs, de l'audit de la dette aux promesses de re-nationalisation. Leur mode d'organisation et leur leadership, par contre, divergent. Décryptage croisé des deux formations qui vont marquer 2015.
 Alexis Tsipras et Pablo Iglesias le 15 novembre 2014 à Madrid. © Juan Medina / Reuters.
1 - Deux structures politiques à l'opposé
Alexis Tsipras et Pablo Iglesias le 15 novembre 2014 à Madrid. © Juan Medina / Reuters.
1 - Deux structures politiques à l'opposé
Difficile de faire plus différent, en termes d'organisation, entre Podemos et Syriza. Leurs histoires respectives n'ont rien à voir. Créé en 2004, Syriza – acronyme qui signifie en grec « coalition de la gauche radicale » –, est un regroupement de partis de gauche, où l'on trouve des écologistes radicaux, d'ex-communistes ralliés à l'Europe (qui se sont séparés des communistes orthodoxes du KKE) ou encore des trotskistes et des maoïstes. Réalisant jusqu'alors des scores plutôt modestes, Syriza décolle aux législatives de 2012, accrochant la deuxième place. Il met alors fin au bipartisme Parti socialiste (PASOK) – Nouvelle démocratie, qui caractérisait la vie politique grecque depuis la fin de la dictature des colonels. Un an plus tard, lors de son congrès de 2013, la coalition se dote de structures unifiées.
« Syriza n'a jamais cherché à réfuter la forme du “parti”. Ce n'est pas un parti qui nie ses origines ou qui préfère éviter d'être étiqueté de gauche », commente le politologue Luis Ramiro, de l'université de Leicester (Grande-Bretagne), un spécialiste des gauches européennes, interrogé par le site d'informations espagnol InfoLibre. Si l'on devait trouver un partenaire naturel à Syriza en Espagne, ce serait plutôt Izquierda Unida (IU), qui rassemble communistes et écolos radicaux. Or, IU est désormais considéré comme un représentant de la « caste » par Podemos.
Podemos a surgi en janvier 2014. Son succès aux européennes de mai, où il talonne, à la surprise quasi-générale, Izquierda Unida, est une détonation dans le paysage national, marqué depuis plus de trente ans par un sage bipartisme entre PP (droite au pouvoir) et PSOE (socialistes, opposition). À l'origine, le poumon de Podemos est son réseau de « circulos », ces assemblées aux quatre coins du pays, censées fixer les orientations du collectif, dans la droite ligne du mouvement « indigné » surgi en 2011. Depuis le congrès madrilène d'octobre 2014, l'organisation s'est « verticalisée », avec un secrétaire général tout puissant (Pablo Iglesias) et sa garde rapprochée, qui ont la main sur l'ensemble des décisions. Elle s'est ainsi froissée avec une partie des « Indignés », qui y voient une trahison de leurs idéaux. Iglesias et ses proches justifient ses décisions au nom de l'efficacité politique : c'est la seule manière, disent-ils, de pouvoir remporter les législatives de l'automne prochain.
« La direction de Podemos détient plus de pouvoir (que celle de Syriza – ndlr) et ses guerres internes sont nettement moins consolidées », décrypte Guillem Vidal, un universitaire de l'institut européen de Florence, interrogé par InfoLibre. De manière assez classique pour ce type de formation, Syriza est parcourue de débats vifs en son sein, entre une aile gauche plus radicale, et une majorité – autour de 60 % de sa base – plus modérée. Mais la formation de Tsipras présente, assure Vidal, « une structure beaucoup plus solide, tandis que Podemos, elle, est plus volatile ». « Syriza est un parti qui se situe clairement à gauche, et qui ne peut pas jouer le jeu du discours ambigu à la Podemos », poursuit-il. Podemos prend soin, en effet, de refuser toute étiquette de parti de gauche, soucieux de séduire également des déçus de la droite espagnole, déstabilisée par des scandales de corruption en cascade.
2 - Quelle majorité pour gouverner ?
Les deux formations ont beau être des objets politiques très différents, Syriza et Podemos pourraient bien être confrontées à une même difficulté en 2015, même si elles arrivent en tête à la sortie des urnes : former une majorité au sein de leur parlement, pour gouverner. Pour Syriza, que les sondages créditent d'environ 30 % des voix, l'équation est connue : il faut trouver 151 sièges sur 300 députés à l'Assemblée. Même si la Constitution grecque donne une prime de 50 députés au premier parti élu à l'Assemblée, Syriza devra donc nouer des alliances – peut-être avec la gauche modérée de Dimar, ou avec les Grecs indépendants, un petit parti de droite, anti-austérité.
En Espagne, la difficulté est identique. Même si Podemos arrive en tête des législatives à l'automne, il n'est pas du tout exclu que le PP et le PSOE, ses deux principaux concurrents, forment une union nationale, en forme de cordon sanitaire… La question d'une alliance avec IU, dans ce contexte, se reposera sans doute. Difficulté supplémentaire, côté espagnol : les législatives sont encore lointaines, et Podemos devra, d'ici là, se livrer à une course d'obstacles dans laquelle il pourrait laisser des plumes (élections municipales et régionales en mai).
Après avoir, dans un premier temps, assuré qu'ils faisaient l'impasse sur les municipales, Podemos devrait tout de même présenter des candidats, dans certaines grandes villes, à partir de plateformes élargies aux contours encore à définir. À l'inverse, Syriza détient déjà quelques municipalités et dirige depuis quelques mois l'Attique, la région d'Athènes. Quoi qu'il en soit, certains pronostiquent déjà, en Grèce comme en Espagne, un « adoucissement » des positions des deux formations, à l'approche des élections.
3 - Oui à un audit de la dette, non à la sortie de l'euro
C'est l'un des points centraux, et communs, de leur programme : un audit de la dette publique. L'objectif est connu : passer en revue la dette accumulée au fil des années, pour, sinon annuler de manière unilatérale les pans de la dette considérée comme « illégitime », en tout cas renégocier son remboursement avec ses créanciers. L'opération doit permettre, en bout de course, de retrouver des marges de manœuvre budgétaires, pour faire autre chose que de l'austérité. Chez Syriza, la suite logique, c'est de renégocier les « mémorandums » imposés par la Troïka BCE-FMI-Commission à Athènes, en échange des plans de « sauvetage » du pays mis en place en 2010, puis en 2012. Pour rassurer les inquiets, Tsipras et ses proches répètent depuis des semaines qu'ils ne prendront aucune décision de manière « unilatérale » pour renégocier le fardeau de la dette : un discours nettement adouci par rapport à 2012, où Syriza parlait de mémorandum sur le paiement de la dette avant toute négociation. Dans son programme issu de son congrès de 2013, les objectifs de Syriza sont exprimés ainsi : « Nous renégocions les conventions de prêts et nous en rendons caducs les termes défavorables, en posant comme sujet n°1 l'effacement de la plus grande partie de la dette avec la réalisation d'un audit. »
Si l'on lit le programme économique de Podemos (élaboré par deux économistes d'obédience keynésienne – à télécharger ici), il est question d'une « restructuration » de la dette, à la fois publique, mais aussi de celle des ménages. Celle-ci peut être accompagnée, dans certains cas, d'une « décote » (quita) – c'est-à-dire d'une annulation d'une partie de la dette. « Il est nécessaire de rappeler que la restructuration des dettes, en particulier dans les pays de la périphérie, ne doit pas être un caprice, mais le résultat d'une stratégie coopérative qui s'avérera bien plus favorable que celle imposée jusqu'à présent, et qui risque d'aggraver encore, et de généraliser la crise », lit-on dans le texte. D'où la logique d'une conférence internationale de la dette promise par Tsipras et Iglesias.
Les détails de la manœuvre, à Podemos comme au sein de Syriza, restent flous. Notamment parce que ces annulations, si elles devaient intervenir un jour, seront la conséquence d'une longue négociation avec les créanciers… Quoi qu'il en soit, les deux formations sont persuadées que lancer cette renégociation ne les obligera pas à quitter l'euro. La sortie de la zone euro ne fait partie de leur programme – même si une aile franchement eurosceptique de Syriza, minoritaire, le réclame, comme l'a déjà raconté Mediapart.
Pas de rupture avec l'euro, mais une réforme de la BCE – les deux formations sont dans la droite ligne des discours de la GUE, la gauche unitaire européenne au Parlement de Strasbourg. Dans le programme de Podemos, il est question d'une modification des statuts de la BCE, pour faire du plein emploi l'un de ses objectifs, ou encore d'une démocratisation de cette institution, qui devrait être, jugent-ils, davantage responsable de ses décisions devant le Parlement européen. La formation plaide aussi pour une « flexibilisation » du pacte de stabilité budgétaire – ce qui est aussi une réclamation du social-démocrate italien Matteo Renzi depuis son arrivée au pouvoir en début d'année – ou encore pour une hausse du budget propre à l'UE – autre réclamation assez consensuelle au sein des partis sociaux-démocrates.
 Alexis Tsipras, le 6 mai 2012. © Reuters
Dans un entretien
à Mediapart en avril 2014 où il plaidait pour une démocratisation des
institutions européennes, Alexis Tsipras était parti en guerre contre
les indicateurs purement économiques et budgétaires du pacte de
stabilité de l'UE : « Je ne vois pas pourquoi nous devons tous être
d'accord avec les 3 % de déficit public, le ratio de 60 % du PIB pour la
dette, la limite des 2 % d'inflation… sans considérer comme indicateur
de viabilité les chiffres du chômage ou le niveau de salaire minimum !
Un pays peut atteindre la limite des 3 % de déficit public en nivelant
complètement la société… Cela ne veut pas dire que c'est un pays
viable ! L'Europe doit donc opérer un véritable virage social, pour
aller vers la justice sociale et la solidarité. » Mais sa stratégie,
pour faire évoluer ces critères alors qu'il sera, s'il est élu,
ultra-minoritaire à la table du conseil européen à Bruxelles, reste très
floue.
Alexis Tsipras, le 6 mai 2012. © Reuters
Dans un entretien
à Mediapart en avril 2014 où il plaidait pour une démocratisation des
institutions européennes, Alexis Tsipras était parti en guerre contre
les indicateurs purement économiques et budgétaires du pacte de
stabilité de l'UE : « Je ne vois pas pourquoi nous devons tous être
d'accord avec les 3 % de déficit public, le ratio de 60 % du PIB pour la
dette, la limite des 2 % d'inflation… sans considérer comme indicateur
de viabilité les chiffres du chômage ou le niveau de salaire minimum !
Un pays peut atteindre la limite des 3 % de déficit public en nivelant
complètement la société… Cela ne veut pas dire que c'est un pays
viable ! L'Europe doit donc opérer un véritable virage social, pour
aller vers la justice sociale et la solidarité. » Mais sa stratégie,
pour faire évoluer ces critères alors qu'il sera, s'il est élu,
ultra-minoritaire à la table du conseil européen à Bruxelles, reste très
floue.
4 - « Déprivatisations » et stop aux privatisations
Syriza veut l'arrêt des privatisations des biens publics, un sujet de premier plan dans un pays où la Troïka a mis en place un programme gigantesque de privatisations. Alexis Tsipras a également prévenu qu'il suspendrait toute nouvelle cession des propriétés de l'État, quitte à freiner le développement de nouvelles installations touristiques privées (et donc réduire l'arrivée d'investisseurs privés dans le secteur). Dans son programme pour les élections générales de 2012, Syriza parlait aussi de « nationaliser les anciennes entreprises publiques dans les secteurs stratégiques pour la croissance du pays ».
De son côté, Podemos est à peu près sur le même discours. Iglesias a notamment multiplié les sorties, appelant à « dé-privatiser » certains secteurs-clés, en particulier celui de la santé, confronté, en Espagne, à une vague de privatisations impopulaires. En 2012, Syriza parlait aussi de « nationalisation des banques », mais la formation semble, depuis, avoir arrondi les angles. Du côté de Podemos, on ne va pas aussi loin : il est question de renforcer le pôle de la banque publique, pour faciliter les prêts aux petites et moyennes entreprises et aux ménages (via la création, par exemple, d'une banque citoyenne des dépôts).
5 - Vers des hausses de salaires ?
Si Syriza arrive au pouvoir en Grèce, ce sera sans doute l'un des principaux combats avec l'UE et le FMI : Tsipras veut ramener le salaire minimum à ses niveaux d'avant-crise. Il parle aussi du versement d'allocations à tous les chômeurs du pays (la durée maximale d'indemnisation ne dépassant pas aujourd'hui un an). Un sacrilège aux yeux d'institutions internationales persuadées que la sortie de crise passe par un rétablissement de la « compétitivité » du pays. Syriza promet aussi la mise en place de plans alimentaires d'urgence, pour les plus démunis. Le dossier est explosif.
Podemos, comme Syriza, parle de revenus minimum garantis, pour en finir avec l'extrême pauvreté. Comment financer ces annonces ? Les deux formations misent sur une réforme plutôt agressive de la fiscalité. En résumé, cela passe à chaque fois par la création de nouvelles tranches d'imposition sur les revenus pour les plus riches (Podemos va jusqu'à 50 % sur les revenus annuels qui dépassent 120 000 euros).
Ils visent aussi un durcissement de l'impôt sur les sociétés – Tsipras évoque un alignement de l'impôt sur les grosses sociétés au niveau de la moyenne européenne. Il envisage de taxer également les revenus des armateurs grecs, dossier particulièrement sensible dans le pays, et promet d'annuler l'impôt foncier mis en place par l'actuel gouvernement Samaras, qui touche les résidences principales. Sans surprise, Syriza comme Podemos plaident pour une taxe sur les transactions financières – déjà censée voir le jour dans les années à venir dans 11 pays de l'UE.
6 - Tsipras et Iglesias, des leaders charismatiques mais assez différents
Alexis Tsipras est un ancien ingénieur de 40 ans, père de deux garçons. Pablo Iglesias est un politologue de 36 ans, enseignant à l'Université Complutense de Madrid. Les deux sont excellents en communication, ils ont donné un sérieux coup de vieux au personnel politique de leurs pays, et leur personnalité n'est pas pour rien dans le succès de leur formation. Mais la comparaison s'arrête là.
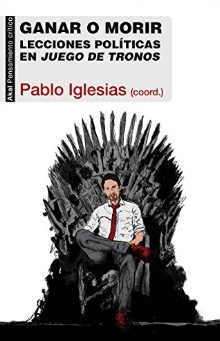 Tsipras est « un produit de l'appareil du parti, il a eu le parcours typique de l'apparatchik », expliquait un politologue, Ioannis Papadopoulos, interrogé par Libération
au printemps 2014. Tsipras adhère à 16 ans aux jeunesses communistes. À
l'université, il prend ses distances avec les communistes orthodoxes du
KKE. Il devient secrétaire général du mouvement de jeunesse du
Synaspismos, la principale composante du futur Syriza, à 25 ans, et
entre au comité central du parti lors de sa création, en 2004, avant
d'en prendre les rênes en 2008.
Tsipras est « un produit de l'appareil du parti, il a eu le parcours typique de l'apparatchik », expliquait un politologue, Ioannis Papadopoulos, interrogé par Libération
au printemps 2014. Tsipras adhère à 16 ans aux jeunesses communistes. À
l'université, il prend ses distances avec les communistes orthodoxes du
KKE. Il devient secrétaire général du mouvement de jeunesse du
Synaspismos, la principale composante du futur Syriza, à 25 ans, et
entre au comité central du parti lors de sa création, en 2004, avant
d'en prendre les rênes en 2008.
Iglesias, un temps passé par Izquierda Unida, n'a jamais joué la carte du parti. Il s'est construit une notoriété par internet, en créant son propre média (La Tuerka), qui diffuse depuis des années des émissions long format, entre éducation populaire et débat politique haut de gamme. L'Espagnol – qui compte plus de 730 000 abonnés sur Twitter – s'adresse très bien à une jeunesse désenchantée par la politique, à travers toute une série de références qu'il emprunte à internet, au hip-hop ou aux séries télé. Ce fan de Game of Thrones n'a pas hésité, il y a quelques jours, à commenter, dans un mélange d'anglais et d'espagnol, la situation politique de son pays en reprenant une réplique culte de la saga : « Winter is coming para el gobierno de Rajoy. » On imagine mal Alexis Tsipras, qu'on dit fan des Dire Straits, oser ce genre de sorties.
Syriza, Podemos : à eux deux, ces mouvements politiques, qui siègent ensemble à Strasbourg sous la bannière de la Gauche unitaire européenne (GUE), tiennent une bonne partie de l'avenir de l'UE entre leurs mains. Rien n'est fait mais, sur le papier, ils ont les moyens de faire bouger cette « Europe allemande » théorisée par le sociologue Ulrich Beck, à laquelle s'est heurté François Hollande. Cinq ans après l'éclatement de la crise des dettes souveraines en Europe, et autant d'années d'austérité sur le continent, ce serait une première, pour tester des alternatives dans l'Europe du Sud.
Les deux formations anti-austérité le savent, et leurs leaders – le Grec Alexis Tsipras, 40 ans, et l'Espagnol Pablo Iglesias, 36 ans – ne manquent pas une occasion de mettre en scène leur union politique. Lundi, après l'annonce du scrutin grec anticipé, Iglesias a encouragé, sur Twitter, son collègue : « 2015 sera l'année du changement en Espagne et en Europe. Ça commencera par la Grèce. En avant Alexis ! » En octobre 2014, lors d'un acte commun à Athènes, Tsipras avait déjà prévenu : « Podemos peut devenir l'autre Syriza en Europe, le Syriza espagnol. »
Dans une tribune publiée le 30 décembre dans le quotidien conservateur El Mundo, Pablo Iglesias en rajoute une couche : « Alexis sait tout autant que nous que remporter une élection ne suffit pas pour prendre le pouvoir, et que la marge d'action dans le contexte actuel et inévitable de l'Union, est étroite. Mais il sait aussi, tout autant que nous, que des vents de changement soufflent, et que les peuples du Sud de l'Europe (…) sont prêts à changer de cap, et à avancer vers une Europe où la justice sociale et la souveraineté populaire formeront les bases d'une démocratie qui saura s'imposer face à la peur. »
À première vue, les deux économies sont très différentes – la Grèce ne pèse plus que 2 % du PIB de la zone euro, contre 12 % pour l'Espagne (et 20 % pour la France). Mais les programmes de Syriza et Podemos présentent de nombreux points communs, de l'audit de la dette aux promesses de re-nationalisation. Leur mode d'organisation et leur leadership, par contre, divergent. Décryptage croisé des deux formations qui vont marquer 2015.
Difficile de faire plus différent, en termes d'organisation, entre Podemos et Syriza. Leurs histoires respectives n'ont rien à voir. Créé en 2004, Syriza – acronyme qui signifie en grec « coalition de la gauche radicale » –, est un regroupement de partis de gauche, où l'on trouve des écologistes radicaux, d'ex-communistes ralliés à l'Europe (qui se sont séparés des communistes orthodoxes du KKE) ou encore des trotskistes et des maoïstes. Réalisant jusqu'alors des scores plutôt modestes, Syriza décolle aux législatives de 2012, accrochant la deuxième place. Il met alors fin au bipartisme Parti socialiste (PASOK) – Nouvelle démocratie, qui caractérisait la vie politique grecque depuis la fin de la dictature des colonels. Un an plus tard, lors de son congrès de 2013, la coalition se dote de structures unifiées.
« Syriza n'a jamais cherché à réfuter la forme du “parti”. Ce n'est pas un parti qui nie ses origines ou qui préfère éviter d'être étiqueté de gauche », commente le politologue Luis Ramiro, de l'université de Leicester (Grande-Bretagne), un spécialiste des gauches européennes, interrogé par le site d'informations espagnol InfoLibre. Si l'on devait trouver un partenaire naturel à Syriza en Espagne, ce serait plutôt Izquierda Unida (IU), qui rassemble communistes et écolos radicaux. Or, IU est désormais considéré comme un représentant de la « caste » par Podemos.
Podemos a surgi en janvier 2014. Son succès aux européennes de mai, où il talonne, à la surprise quasi-générale, Izquierda Unida, est une détonation dans le paysage national, marqué depuis plus de trente ans par un sage bipartisme entre PP (droite au pouvoir) et PSOE (socialistes, opposition). À l'origine, le poumon de Podemos est son réseau de « circulos », ces assemblées aux quatre coins du pays, censées fixer les orientations du collectif, dans la droite ligne du mouvement « indigné » surgi en 2011. Depuis le congrès madrilène d'octobre 2014, l'organisation s'est « verticalisée », avec un secrétaire général tout puissant (Pablo Iglesias) et sa garde rapprochée, qui ont la main sur l'ensemble des décisions. Elle s'est ainsi froissée avec une partie des « Indignés », qui y voient une trahison de leurs idéaux. Iglesias et ses proches justifient ses décisions au nom de l'efficacité politique : c'est la seule manière, disent-ils, de pouvoir remporter les législatives de l'automne prochain.
« La direction de Podemos détient plus de pouvoir (que celle de Syriza – ndlr) et ses guerres internes sont nettement moins consolidées », décrypte Guillem Vidal, un universitaire de l'institut européen de Florence, interrogé par InfoLibre. De manière assez classique pour ce type de formation, Syriza est parcourue de débats vifs en son sein, entre une aile gauche plus radicale, et une majorité – autour de 60 % de sa base – plus modérée. Mais la formation de Tsipras présente, assure Vidal, « une structure beaucoup plus solide, tandis que Podemos, elle, est plus volatile ». « Syriza est un parti qui se situe clairement à gauche, et qui ne peut pas jouer le jeu du discours ambigu à la Podemos », poursuit-il. Podemos prend soin, en effet, de refuser toute étiquette de parti de gauche, soucieux de séduire également des déçus de la droite espagnole, déstabilisée par des scandales de corruption en cascade.
2 - Quelle majorité pour gouverner ?
Les deux formations ont beau être des objets politiques très différents, Syriza et Podemos pourraient bien être confrontées à une même difficulté en 2015, même si elles arrivent en tête à la sortie des urnes : former une majorité au sein de leur parlement, pour gouverner. Pour Syriza, que les sondages créditent d'environ 30 % des voix, l'équation est connue : il faut trouver 151 sièges sur 300 députés à l'Assemblée. Même si la Constitution grecque donne une prime de 50 députés au premier parti élu à l'Assemblée, Syriza devra donc nouer des alliances – peut-être avec la gauche modérée de Dimar, ou avec les Grecs indépendants, un petit parti de droite, anti-austérité.
En Espagne, la difficulté est identique. Même si Podemos arrive en tête des législatives à l'automne, il n'est pas du tout exclu que le PP et le PSOE, ses deux principaux concurrents, forment une union nationale, en forme de cordon sanitaire… La question d'une alliance avec IU, dans ce contexte, se reposera sans doute. Difficulté supplémentaire, côté espagnol : les législatives sont encore lointaines, et Podemos devra, d'ici là, se livrer à une course d'obstacles dans laquelle il pourrait laisser des plumes (élections municipales et régionales en mai).
Après avoir, dans un premier temps, assuré qu'ils faisaient l'impasse sur les municipales, Podemos devrait tout de même présenter des candidats, dans certaines grandes villes, à partir de plateformes élargies aux contours encore à définir. À l'inverse, Syriza détient déjà quelques municipalités et dirige depuis quelques mois l'Attique, la région d'Athènes. Quoi qu'il en soit, certains pronostiquent déjà, en Grèce comme en Espagne, un « adoucissement » des positions des deux formations, à l'approche des élections.
3 - Oui à un audit de la dette, non à la sortie de l'euro
C'est l'un des points centraux, et communs, de leur programme : un audit de la dette publique. L'objectif est connu : passer en revue la dette accumulée au fil des années, pour, sinon annuler de manière unilatérale les pans de la dette considérée comme « illégitime », en tout cas renégocier son remboursement avec ses créanciers. L'opération doit permettre, en bout de course, de retrouver des marges de manœuvre budgétaires, pour faire autre chose que de l'austérité. Chez Syriza, la suite logique, c'est de renégocier les « mémorandums » imposés par la Troïka BCE-FMI-Commission à Athènes, en échange des plans de « sauvetage » du pays mis en place en 2010, puis en 2012. Pour rassurer les inquiets, Tsipras et ses proches répètent depuis des semaines qu'ils ne prendront aucune décision de manière « unilatérale » pour renégocier le fardeau de la dette : un discours nettement adouci par rapport à 2012, où Syriza parlait de mémorandum sur le paiement de la dette avant toute négociation. Dans son programme issu de son congrès de 2013, les objectifs de Syriza sont exprimés ainsi : « Nous renégocions les conventions de prêts et nous en rendons caducs les termes défavorables, en posant comme sujet n°1 l'effacement de la plus grande partie de la dette avec la réalisation d'un audit. »
Si l'on lit le programme économique de Podemos (élaboré par deux économistes d'obédience keynésienne – à télécharger ici), il est question d'une « restructuration » de la dette, à la fois publique, mais aussi de celle des ménages. Celle-ci peut être accompagnée, dans certains cas, d'une « décote » (quita) – c'est-à-dire d'une annulation d'une partie de la dette. « Il est nécessaire de rappeler que la restructuration des dettes, en particulier dans les pays de la périphérie, ne doit pas être un caprice, mais le résultat d'une stratégie coopérative qui s'avérera bien plus favorable que celle imposée jusqu'à présent, et qui risque d'aggraver encore, et de généraliser la crise », lit-on dans le texte. D'où la logique d'une conférence internationale de la dette promise par Tsipras et Iglesias.
Les détails de la manœuvre, à Podemos comme au sein de Syriza, restent flous. Notamment parce que ces annulations, si elles devaient intervenir un jour, seront la conséquence d'une longue négociation avec les créanciers… Quoi qu'il en soit, les deux formations sont persuadées que lancer cette renégociation ne les obligera pas à quitter l'euro. La sortie de la zone euro ne fait partie de leur programme – même si une aile franchement eurosceptique de Syriza, minoritaire, le réclame, comme l'a déjà raconté Mediapart.
Pas de rupture avec l'euro, mais une réforme de la BCE – les deux formations sont dans la droite ligne des discours de la GUE, la gauche unitaire européenne au Parlement de Strasbourg. Dans le programme de Podemos, il est question d'une modification des statuts de la BCE, pour faire du plein emploi l'un de ses objectifs, ou encore d'une démocratisation de cette institution, qui devrait être, jugent-ils, davantage responsable de ses décisions devant le Parlement européen. La formation plaide aussi pour une « flexibilisation » du pacte de stabilité budgétaire – ce qui est aussi une réclamation du social-démocrate italien Matteo Renzi depuis son arrivée au pouvoir en début d'année – ou encore pour une hausse du budget propre à l'UE – autre réclamation assez consensuelle au sein des partis sociaux-démocrates.
4 - « Déprivatisations » et stop aux privatisations
Syriza veut l'arrêt des privatisations des biens publics, un sujet de premier plan dans un pays où la Troïka a mis en place un programme gigantesque de privatisations. Alexis Tsipras a également prévenu qu'il suspendrait toute nouvelle cession des propriétés de l'État, quitte à freiner le développement de nouvelles installations touristiques privées (et donc réduire l'arrivée d'investisseurs privés dans le secteur). Dans son programme pour les élections générales de 2012, Syriza parlait aussi de « nationaliser les anciennes entreprises publiques dans les secteurs stratégiques pour la croissance du pays ».
De son côté, Podemos est à peu près sur le même discours. Iglesias a notamment multiplié les sorties, appelant à « dé-privatiser » certains secteurs-clés, en particulier celui de la santé, confronté, en Espagne, à une vague de privatisations impopulaires. En 2012, Syriza parlait aussi de « nationalisation des banques », mais la formation semble, depuis, avoir arrondi les angles. Du côté de Podemos, on ne va pas aussi loin : il est question de renforcer le pôle de la banque publique, pour faciliter les prêts aux petites et moyennes entreprises et aux ménages (via la création, par exemple, d'une banque citoyenne des dépôts).
5 - Vers des hausses de salaires ?
Si Syriza arrive au pouvoir en Grèce, ce sera sans doute l'un des principaux combats avec l'UE et le FMI : Tsipras veut ramener le salaire minimum à ses niveaux d'avant-crise. Il parle aussi du versement d'allocations à tous les chômeurs du pays (la durée maximale d'indemnisation ne dépassant pas aujourd'hui un an). Un sacrilège aux yeux d'institutions internationales persuadées que la sortie de crise passe par un rétablissement de la « compétitivité » du pays. Syriza promet aussi la mise en place de plans alimentaires d'urgence, pour les plus démunis. Le dossier est explosif.
Podemos, comme Syriza, parle de revenus minimum garantis, pour en finir avec l'extrême pauvreté. Comment financer ces annonces ? Les deux formations misent sur une réforme plutôt agressive de la fiscalité. En résumé, cela passe à chaque fois par la création de nouvelles tranches d'imposition sur les revenus pour les plus riches (Podemos va jusqu'à 50 % sur les revenus annuels qui dépassent 120 000 euros).
Ils visent aussi un durcissement de l'impôt sur les sociétés – Tsipras évoque un alignement de l'impôt sur les grosses sociétés au niveau de la moyenne européenne. Il envisage de taxer également les revenus des armateurs grecs, dossier particulièrement sensible dans le pays, et promet d'annuler l'impôt foncier mis en place par l'actuel gouvernement Samaras, qui touche les résidences principales. Sans surprise, Syriza comme Podemos plaident pour une taxe sur les transactions financières – déjà censée voir le jour dans les années à venir dans 11 pays de l'UE.
6 - Tsipras et Iglesias, des leaders charismatiques mais assez différents
Alexis Tsipras est un ancien ingénieur de 40 ans, père de deux garçons. Pablo Iglesias est un politologue de 36 ans, enseignant à l'Université Complutense de Madrid. Les deux sont excellents en communication, ils ont donné un sérieux coup de vieux au personnel politique de leurs pays, et leur personnalité n'est pas pour rien dans le succès de leur formation. Mais la comparaison s'arrête là.
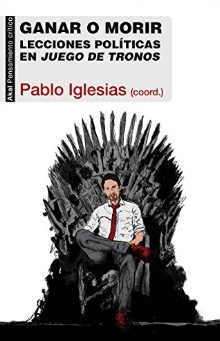
Iglesias, un temps passé par Izquierda Unida, n'a jamais joué la carte du parti. Il s'est construit une notoriété par internet, en créant son propre média (La Tuerka), qui diffuse depuis des années des émissions long format, entre éducation populaire et débat politique haut de gamme. L'Espagnol – qui compte plus de 730 000 abonnés sur Twitter – s'adresse très bien à une jeunesse désenchantée par la politique, à travers toute une série de références qu'il emprunte à internet, au hip-hop ou aux séries télé. Ce fan de Game of Thrones n'a pas hésité, il y a quelques jours, à commenter, dans un mélange d'anglais et d'espagnol, la situation politique de son pays en reprenant une réplique culte de la saga : « Winter is coming para el gobierno de Rajoy. » On imagine mal Alexis Tsipras, qu'on dit fan des Dire Straits, oser ce genre de sorties.
Pour écrire cette analyse, nous nous sommes en partie appuyés sur un article publié sur
le site espagnol InfoLibre (partenaire de Mediapart). Nous n'avons pas,
dans cet article déjà très long, abordé, d'autres points des programmes
de Syriza et Podemos, que l'on peut juger tout aussi décisifs (climat,
environnement, logement, etc). Nous aurons sans doute l'occasion d'y
revenir courant 2015.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire